Petite histoire de l'harmonica selon HOHNER
L´histoire d´une branche industrielle
L´histoire de l´harmonica, au sens propre commence à la fin de l´année 1820.
Probablement venant de Vienne ( Autriche) des usines se sont installées en Sachse ( Klingenthal), en
Bohème ( Graslitz) et à Knittlingen près de Pforzheim età Trossingen.
En 1857 Matthias Hohner ,diplômé en horlogerie, construisit son premier harmonica.
Après les premiers pas,la production en masse se développa à Klingenthal et à Trossingen qui devinrent
les plus grands centres de l´harmonica.
En 1903,les usines Koch et Hohner s´engagèrent dans la production mondiale de l’accordéon et conquérirent avec leurs produits de haute qualité le marché international.
En 1929, après le rachat de l’usine Koch, Hohner avait pratiquement atteint le monopole mondial de l´harmonica.
Little Lady de Hohner, le plus petit harmonica du monde arrive sur le marché en 1923.
En 1965, Walter Schirra, capitaine du vaisseau spacial Gémini VI, introduit clandestinement Little
Lady à bord et ainsi résonne, pour la première fois dans l´espace,le son d´un instrument de musique.
L'accordéon: sa genèse
L'accordéon (français), akkordeon ( allemand) ou accordion ( anglais), a connu un développement fondé sur le développement de trois idées et objectifs différents afin de parvenir à sa forme et à sa qualité actuelles:
D’une part, la possibilité de s’exprimer musicalement, d'autre part l’utilisation de anches métalliques libres et finalement la recherche d’un instrument portable à la sonorité fixe.
Les anches libres forment l'âme de l'accordéon: le son est généré par les langues métalliques élastiques, qui sont mises en mouvement par un courant d'air.
Détail important: quelle que soit l'intensité du flux d'air qui frappe la anche, le son reste le même, seule la force sonore change.
Pour permettre à la anche de vibrer, fixez-la à une plaque de métal ou à l’ouverture d’un tuyau, le tout à un endroit où le tirage variable est canalisé en fonction du niveau sonore souhaité.
Avec l'accordéon, l'alimentation en air variable est générée par le soufflet. Cela a l'avantage que la pression de l'air peut être contrôlee en permanence. Ainsi, il est possible d’observer les nuances les plus variées: on peut passer soudainement du pianissimo le plus faible au fortissimo le plus majestueux, c’est-à-dire imiter le ton de la voix humaine, premier modèle de la nature pour ce type de production sonore.
Les instruments accordéon sont portés par le joueur avec des sangles d'épaule; la caisse des aigus est fixe, la caisse de basses pouvant être librement déplacée sur le soufflet situé à gauche. Par le mouvement du soufflet ( ouverture et fermeture ou "tiré" et "poussé") avec la main gauche et le bras gauche, le souffle nécessaire au jeu est généré. Pour que le jeu de doigts sur les boutons de basses soit possible, une lanière est fixée à l'extrémité de la caisse basses, ce qui permet également de guider le soufflet en toute sécurité.
Les types de langue/anche peuvent être divisés en 3 catégories:
- Membrane: cordes vocales humaines, lèvres;
- anche battante: métal brut (en particulier le cuivre), roseau;
- anche libre: divers métaux précieux, etc.
Le meilleur exemple d'instruments à anche libre est la voix humaine, car il contient tous les éléments de l'accordéon: de l'air en mouvement, un récipient pour stocker l'air, des membranes oscillantes.
On sait que la voix humaine apparaît dans le larynx. Au fur et à mesure que vous expirez, au fur et à mesure que l'air stocké sort de vos poumons, vos cordes vocales se frôlent et se mettent à vibrer. La qualité du son dépend de la longueur, de la largeur et de la densité des cordes vocales.
Cette description superficielle et très simplifiée du conduit vocal humain, en réalité très complexe, décrit en termes généraux le fonctionnement des langues vibrantes dans des instruments de musique tels que l'accordéon.
L'ensemble du développement de l'accordéon, de ses origines à nos jours, peut être divisé en trois périodes, chacune produisant un modèle caractéristique développé à partir de plus d'une centaine d'autres:
De 1829 à 1880: l'accordéon en tant que "jouet" avec un seul clavier "triple";
De 1880 à 1950: l'accordéon "populaire" ou "traditionnel" avec deux claviers différents "basse" et "aigu";
depuis 1950: l "accordéon de concert" ou "Harmoneon" à 2 claviers "discants" identiques (invention de Pierre Monichon).
De nos jours, l'accordéon "traditionnel" est le plus connu et le plus joué dans ce genre.
Lors de l'application des anches musique sur la structure métallique, deux principes ont été appliqués: le diatonique et le chromatique (aujourd'hui l'appelation correcte est bi-sonore et unisonore).
Dans l'application diatonique, la note d'une plaquette vibre dans deux tons différents à la pression d'ouverture ou de fermeture du soufflet.
En application chromatique, vous obtenez une seule tonalité, que le soufflet soit poussé ou tiré.
L'explication de ces termes "chromatique (uniformément) / diatonique ( "alternativement" ) peut être trouvée dans le développement de 1880.
Auparavant, il existait des modèles à "gammes diatoniques" et d'autres à demi-tons ("gammes chromatiques") fonctionnant à la fois avec ouverture et fermeture des soufflets.
Lorsqu'il était possible de produire le même ton avec pression et tension du soufflet, le terme "chromatique" prévalait ici.
Pour une meilleure distinction, tous les autres modèles ont été nommés "diatoniques".
Le plus ancien ancêtre de l'accordéon, "Cheng", vient de Chine ( vers 2700 av. J.-C.). Connu sous le nom d '«orgue à bouche» ou bouche eolienne, cet instrument est apparu en Occident dans la première moitié du XIXe siècle et ne servait initialement que pour les voix d'orgue. Afin de garder les mains libres tout en faisant entendre la voix, le Père Buschmann a inventé un soufflet vertical qui s'est relevé et qui est lentement retombé sous son propre poids, générant ainsi automatiquement un flux d'air constant.
Cette "main aeoline", l'ancêtre de l'harmonica et de tous les types d'harmonicas ultérieurs, a été fourni par l’Autrichien Cyrill Demian, luthier à Vienne, avec des touches de basse brevetées en 1829.
Dans la demande de brevet, le nouvel instrument s'appelait "Accordion". Ce changement de nom par Demian est devenu nécessaire car un autre fabricant d'instruments, Eschenbach, avait déjà inventé son instrument inventé en 1820 sous le nom de "Aoline".
Des aéolines à main de Buschmann développées en Allemagne, au soi-disant harmonica allemand sont issues d'une forme subsidiaire "Concertina" (19.06.1829 de Charles Wheatstone) et "Bandonion".
À partir de "l'accordéon" de Demian, le modèle viennois a été formé.
Le premier "Accordion" se présentait sous la forme d'une petite boîte en bois de dimensions 21 x 9 x 6 cm (L xlx H) avec un soufflet double, surmonté de 5 clés, à la pression duquel on actionnait 5 lamelles rectangulaires. Chaque touche produisait deux accords différents (accord à 5 notes de racine), selon que le soufflet était tiré ou tiré.
Très vite, cet "Accordéon" s'est répandu dans les pays voisins et a pris plus de changements.
À partir de 1830, avec l’arrivée des "Accordions", une industrie importante se développe à Paris.
Les premiers fabricants s'appelaient:
* en France: Isaart, Pichenot, Fourneaux, Douce, Busson;
* en Italie: Soprani, Savoia, Pancotti, Socin, Dallape;
* en Russie: Sizov, Volontzov, Chkounaiev;
* en Autriche: Demian, Bichler, Klein, Simon.
Avec le développement du second clavier avec de deux à huit basses pour accompagner l'accordéon, il s'est progressivement intégré dans le folklore de différents pays.
Peu à peu, ils ont commencé à manipuler le soufflet avec une seule main, tandis que le concertina, le bandonéon et d'autres formes dérivées maintenaient le guidage du soufflet à double face.
Cependant, le système de "pull-push" a entravé le développement ultérieur. Par conséquent, trois inventions anonymes ont apporté des améliorations significatives:
• l'application de "Gleichton" (1916);
• la possibilité de créer 60 accords avec 12 tonalités chromatiques;
• l'introduction d'un nouveau clavier à trois rangées.
Après 1900, un modèle standard a prévalu avec 80 basses et trois rangées dans les aigus. De là l'accordéon "traditionnel" est populaire. Vous pouvez le trouver partout, où vous pouvez danser.
À un genre parisien - le "musette" - des noms sont associés tels que Vacher, Peguri, Gardoni, Marceau, Duleu, Prud'homme, Homère, Azzola, Verchuren, Horner.
Les traductions acclamées d'œuvres classiques pour accordéon par E. Lorin et R. Dewaele prouvent les qualités expressives de cet instrument. Peu à peu, les deux types d’instruments, l’accordéon (diatonique) et l’accordéon (chromatique), ont été perfectionnés sur le plan technique et, grâce à des aides à la lecture telles que les registres et l’introduction de basses "chromatiques", leurs possibilités musicales se sont élargies sans cesse.
Ces améliorations ont attiré l'attention u. A. certains compositeurs français tels que G. Auric, J. Fraligaix, J. Lutece, J. Wiener et A. Hoérée; en Allemagne, ce sont principalement C. Mahr et R. Würthner qui ont publié des compositions pour accordéon.
Récemment, le manuel du côté basses de l'accordéon a été étendu par une série permettant la mélodie sur 5 octaves.
Il reste à noter qu'il existe aujourd'hui un accordéon avec deux claviers aigus différents.
Les deux versions sont musicalement équivalentes, mais diffèrent par le type:
L'accordéon à boutons offre une gamme beaucoup plus large que l'accordéon piano.
De plus, le clavier à poignée de bouton est mieux adapté aux conditions anatomiques de la main que le clavier de piano. Cela s'explique par le fait que la portée réduite du bras due à la position verticale du clavier lors de la lecture d'un accordéon pianistique à haute altitude s'avère être un inconvénient.
Néanmoins, l'accordéon pour piano est plus courant que l'accordéon à boutons.
(figure2): Extérieurement, les instruments à la fois diatoniques et chromatiques présentent essentiellement les mêmes caractéristiques et ne diffèrent que légèrement par la construction et la fonction de leurs parties.
Les aigus et les basses sont reliés de manière mobile par un soufflet ( soufflet de lanterne). Du côté des aigus se trouvent le clavier a main (piano ou touche), la couverture des aigus et, intégrée à celle-ci, la barre de registre des aigus. Sous le capot, le mécanisme de rabat est attaché. La partie mélodique est complétée par la table d’harmonie, qui fait face à l’intérieur du soufflet et sur laquelle sont collées les voix. Dans leur construction, ces anches correspondent à celles de l'harmonica: à l'extérieur, les plaquettes fraisées au dos des anches sont fermés par les plaquettes de anches ( individuelles), chacune avec deux anches ( pour aspiration air et compression).
La voix est à plat sur la table d’harmonie et sert à guider et à enregistrer le dispositif de registre.
La partie basse a une structure similaire; Il convient de noter que le clavier (boutons) avec la barre de registre de basse est intégré dans le boîtier, là encore pour accueillir l'anatomie, tandis que le clavier des aigus est logé dans une touche spéciale.
Depuis la demande du brevet déposée par C. Demian à Vienne le 6 mai 1829, plus de 170 ans se sont écoulés, période au cours de laquelle l'accordéon a acquis une notoriété.
Après tout, il est passé d’un jouet à un instrument de concert, est connu de tous les âges et jouit d’une grande popularité dans tous les pays.
Danielle LUDWIG
Remerciements:
MONICHON, Pierre: L'ACCORDEON, Collection "Que sais-je?" n ° 1432, Presses Universitaires de France, 1971
ONE HONEGGER: Science de la musique, Ed. BORDAS
La musique dans l'histoire et le présent, - Band 5 Bärenreiter-Verlag, Kassel et Basel
Traduction libre d'un texte allemand de Danielle LUDWING
* SMAL_Instrument_2002.Doc / © dL 2002
Histoire des Instruments à anches libres
Principe de l'anche libre
Organologiquement, les instruments de musique sont classés par leur mode de production du son. Un instrument à anche libre est un instrument à vent, utilisant un système d'anche en bois ou en métal, fixée d'un côté, et libre de se déplacer de part et d'autre de sa position de repos.
Le déplacement de la colonne d'air pour mettre cette anche en vibration peut être :
- le souffle de l'instrumentiste : harmonicas, mélodicas…
- un mécanisme à bras ou à pieds (ou même parfois à aisselles ou à genoux) : accordéons, harmoniums…
- une soufflerie mécanique : certains tuyaux d'orgues, de positifs, de limonaires…
Le plus ancien instrument à anche libre connu est le sheng, orgue à bouche chinois datant de 3000 ans avant JC.
Liste alphabétique d'instruments à anche libre
Accordéon ( chromatique ou diatonique)
Accordion
Accordina
Bandonéon
Bandonion
Bandonium
Bawu
Concertina
Flutina
Guimbarde
Harmonica
Harmonium
Hulusi
Khên, orgue à bouche d'Asie du Sud-Est
Konzertina
Mélodica
Orgue de Barbarie
Orgue Limonaire
Sheng, orgue à bouche chinois
Shô, orgue à bouche japonais
Shruti box, guide chant indien
Sian, orgue à bouche coréen

RECHERCHER DANS LE SITE
& Instruments aux diapasons anciens, dont le LA=432Hz!!
Accordage, réparation, améliorations.
Restauration, vente, et location
d'instruments d'occasion, anciens et modernes.
Réparation d'appareils électroniques, et vente HI-FI "Vintage"
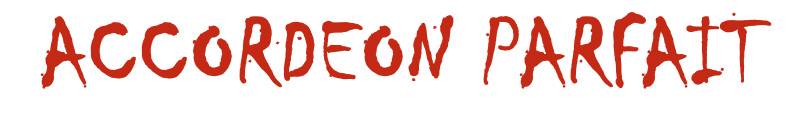
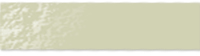
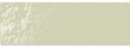
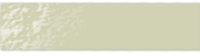
Rechercher dans le site
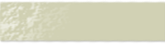

ATELIER DE L'ACCORDEON PARFAIT
558 route de monteils
Floirac - 12200 MONTEILS
Téléphone : 06.76.28.14.46 - 09.50.62.83.01
Web : www.accordeonparfait.com
